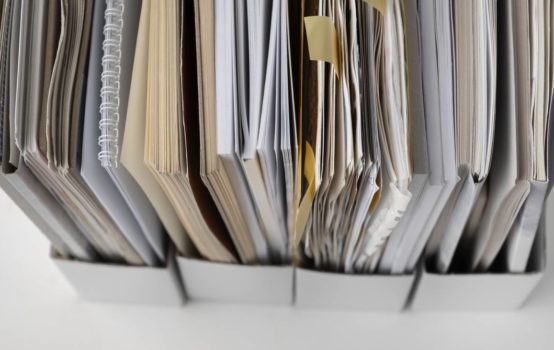Les dark patterns : quand la conception de l’UX défie le RGPD
Les dark patterns (ou « interfaces truquées ») désignent des pratiques de conception délibérément trompeuses ou biaisées, destinées à orienter les utilisateurs vers des choix favorables à l’opérateur du service, souvent au détriment de leur compréhension, de leur intérêt ou de leur liberté réelle de décision.
Ces pratiques sont malheureusement devenues de plus en plus courantes depuis la mise en application du Règlement Général sur la Protection des Données, dans une volonté de certaines entreprises de contourner les exigences relatives au traitement éthique des données.
Dans cet article, nos experts consultants RGPD vous expliquent tout ce qu’il faut savoir sur les dark patterns, ainsi que les méthodes pour les identifier et les éviter.
Dark Patterns et RGPD
Le RGPD encadre strictement les conditions de validité du consentement et les modalités d’information des personnes concernées :
- Article 4.11 1 : le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque.
- Article 7 2 : il doit être aussi facile de retirer son consentement que de le donner.
- Article 12 3 : l’information doit être fournie de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible.
Dans l’environnement numérique, la conception même d’une interface, site web ou application, peut influencer, orienter, voire manipuler les choix de l’utilisateur. C’est précisément l’enjeu des dark patterns, ces pratiques de design qui, sous couvert d’ergonomie ou de performance commerciale, induisent l’utilisateur en erreur ou le conduisent à consentir à un traitement qu’il n’aurait pas accepté en toute liberté.
Appliquées au traitement des données personnelles, ces pratiques sont susceptibles d’enfreindre plusieurs principes du RGPD, notamment ceux relatifs à la licéité du consentement, à la transparence et à la loyauté du traitement.
Exemples concrets de dark patterns contraires au RGPD
Voici quelques pratiques trompeuses fréquemment identifiées par les autorités de protection des données :
- Consentement forcé : une bannière cookies ne propose qu’un bouton « Accepter tout » clairement visible, tandis que les options « Refuser » ou « Paramétrer » sont dissimulées, peu visibles (texte grisé, taille réduite) ou enfouies dans plusieurs sous-menus.
- Précochage de cases de consentement : une case « Je souhaite recevoir des offres commerciales » est cochée par défaut lors de l’inscription à un service, en violation du principe de consentement actif.
- Labyrinthes de désinscription : l’utilisateur doit naviguer à travers plusieurs écrans, cliquer sur de nombreux liens, voire justifier son choix, pour se désabonner d’un service ou d’une communication.
- Masquage d’options favorables à la personne concernée : l’option « Continuer sans créer de compte » est affichée en gris clair, placée en bas de page ou dissimulée sous un lien secondaire.
- Ambiguïté syntaxique : les messages affichés sont volontairement ambigus ou confus, de manière à dissimuler la finalité réelle du traitement ou à induire l’utilisateur en erreur.
Parcours labyrinthiques pour retirer son consentement ou exercer ses droits : les modalités de retrait du consentement, de modification des préférences ou d’exercice des droits sont inutilement complexes ou dissuasives.
La position des autorités de contrôle sur les Dark Patterns
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, comme ses homologues européennes, a fermement condamné les dark patterns dans plusieurs décisions récentes. A titre d’exemple, en 2022, elle a mis en demeure plusieurs sites pour non-conformité des bandeaux cookies, estimant que l’architecture du choix était manifestement déséquilibrée.
Au niveau européen, les lignes directrices et prises de position du CEPD réaffirment que la conception des interfaces ne doit en aucun cas entraver ou fausser l’exercice libre et éclairé des choix des personnes concernées.
Recommandations pratiques pour une UX conforme
Voici quelques conseils des experts consultants RGPD de Data Legal Drive – EQS Group afin d’éviter les Dark Patterns et vous assurer ainsi une expérience utilisateur conforme au RGPD :
Concevoir une interface éthique
Éviter les choix asymétriques (par exemple, accepter en un clic vs. refuser en plusieurs étapes). Veiller à ce que les boutons « Accepter » et « Refuser » aient une visibilité équivalente. Fournir une information claire, structurée et immédiatement accessible, de manière à ce que l’utilisateur puisse prendre des décisions éclairées et en toute liberté.
Valider la licéité du consentement
Intégrer systématiquement des revues UX-RGPD lors de la phase de conception. Documenter les choix de design en les inscrivant dans une logique de privacy by design et de privacy by default. Impliquer les DPO dès l’amont des projets digitaux afin de garantir la conformité des interfaces avec les exigences du RGPD.
Accompagner les équipes produit et marketing
Former les UX/UI designers à la réglementation relative à la protection des données personnelles. Diffuser des guides internes de conception éthique. Mettre en place des contrôles réguliers sur les interfaces en production, afin de garantir leur conformité continue.
Les dark patterns ne constituent pas simplement un défaut de design, mais peuvent refléter un choix stratégique contraire aux droits des personnes. Si le RGPD impose un cadre rigoureux, il ouvre également une opportunité : celle de créer des interfaces respectueuses de la volonté réelle de l’utilisateur.
En plaçant l’éthique de la conception au cœur de la conformité, les organisations peuvent allier performance digitale et protection des droits fondamentaux, tout en renforçant la confiance numérique.
Sources
1 RGPD article 4, site de la CNIL
2 RGPD article 7, site de la CNIL
3 RGPD article 12, site de la CNIL